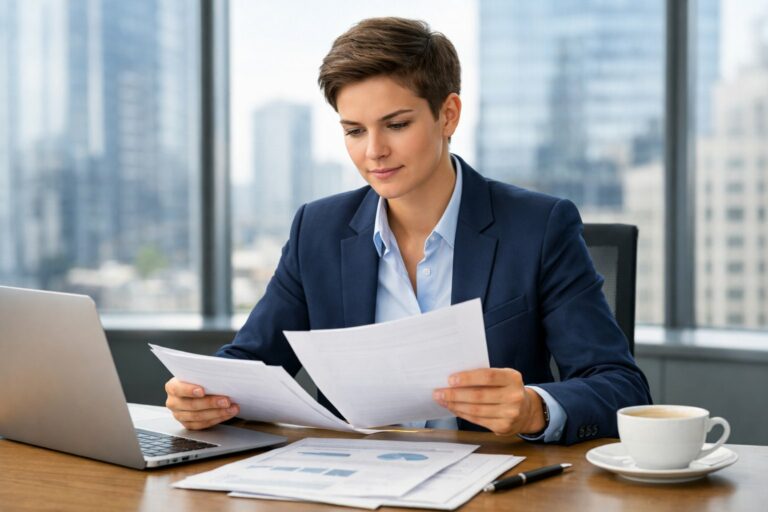Le marché public de tourisme durable est un contrat passé entre une entité publique et une entreprise afin de développer des activités touristiques respectueuses de l’environnement et des enjeux sociaux. Remporter ces marchés demande de comprendre les critères de sélection, d’intégrer une démarche responsable et de présenter une offre innovante.
Définition simple :\
Le marché public de tourisme durable consiste à proposer des solutions concrètes et mesurables pour allier attractivité touristique, respect de l’environnement et développement local.
Quelles sont les clés pour remporter un marché public de tourisme durable ?
- Prendre en compte les critères de développement durable dans l’offre.
- Présenter des engagements concrets en matière de responsabilité sociétale et environnementale.
- Intégrer des solutions innovantes favorisant la transition écologique.
- Mettre en avant la qualité des services et la gestion efficace des ressources.
Comment construire une offre compétitive pour ce type de marché ?
- Adapter l’offre aux besoins spécifiques précisés dans le cahier des charges.
- Proposer des indicateurs de performance pour mesurer l’impact durable.
- Soigner la présentation du dossier et respecter strictement les délais.
- Valoriser l’expertise de l’équipe sur les problématiques environnementales.
En résumé, remporter un marché public de tourisme durable repose sur la capacité à proposer une offre structurée, responsable et adaptée aux attentes spécifiques des acheteurs publics, tout en mettant en avant l’innovation et la qualité des engagements pris.
Points clés
- Comprendre les attentes des marchés publics de tourisme durable est crucial.
- Intégrer la RSE et des solutions innovantes renforce l’offre.
- La présentation claire et la pertinence des actions garantissent la compétitivité.
Comprendre les marchés publics de tourisme durable

Le tourisme durable devient un critère clé dans l’attribution des marchés publics face aux exigences environnementales et sociales croissantes. Les acheteurs publics attendent des offres qui intègrent la responsabilité sociale, la protection de l’environnement, et une gestion efficace des ressources tout au long du cycle de vie du projet.
Définition du tourisme durable
Le tourisme durable se définit comme une approche visant à limiter les impacts négatifs sur l’environnement et à maximiser les bénéfices économiques et sociaux pour les populations locales.\
Il repose sur trois piliers : la préservation de l’environnement, l’équité sociale et la viabilité économique.
Les pratiques recherchées par les acheteurs publics incluent la gestion de la consommation d’énergie et d’eau, la valorisation de la biodiversité, l’intégration des communautés et la réduction des déchets générés par l’activité touristique.
Des labels et certifications, comme la norme ISO 14001 ou la marque « Tourisme & Handicap », démontrent l’engagement d’un opérateur. Les entreprises sont donc incitées à adapter leur offre pour répondre à ces attentes concrètes, sous peine d’être écartées lors des procédures de sélection.
Spécificités des marchés publics dans le secteur touristique
Les marchés publics de tourisme durable se distinguent par des exigences précises liées aux besoins des collectivités et aux objectifs de développement durable.\
Les acheteurs publics privilégient des prestations intégrant la gestion responsable des flux touristiques, la protection du patrimoine naturel et culturel, et la réduction de l’empreinte carbone.
Les offres sont évaluées selon des critères multiples :
- Caractéristiques environnementales de l’offre (réduction des impacts, éco-conception)
- Inclusion sociale (accessibilité, implication des acteurs locaux)
- Performance économique (coût global, durabilité des équipements et services)
La transversalité des besoins pousse les entreprises à proposer des solutions innovantes et adaptées à chaque territoire.
Typologies des appels d’offres pour le tourisme durable
Les appels d’offres couvrent différents segments, allant de la gestion d’infrastructures écotouristiques à l’organisation d’événements responsables et au développement de circuits locaux.\
Parmi les typologies courantes :
| Type d’appel d’offres | Exemples de prestations attendues |
|---|---|
| Hébergement durable | Hôtels écoresponsables, rénovations basse consommation |
| Transport doux | Navettes électriques, mobilités actives |
| Animation et médiation | Visites guidées nature, sensibilisation des visiteurs |
| Gestion de sites naturels | Aménagements légers, maintien de la biodiversité |
Les acheteurs publics recherchent systématiquement la preuve d’engagement environnemental et d’intégration dans des démarches territoriales, notamment dans la gestion des flux ou l’éco-conception des activités.\
L’analyse des besoins spécifiques du territoire demeure une étape incontournable pour répondre efficacement à ces offres.
Cadre réglementaire et critères de sélection

Le succès dans les marchés publics de tourisme durable repose sur la compréhension précise du cadre légal, la bonne intégration du développement durable dans les offres et l’anticipation des exigences spécifiques des acheteurs publics responsables.
Lois et directives applicables aux marchés publics durables
Les marchés publics en France sont encadrés par le Code de la commande publique, qui définit les règles applicables à l’attribution et à l’exécution des contrats pour les entités publiques.
Ce cadre impose la transparence des procédures avec des obligations de publicité et de communication des critères de sélection. Les acheteurs publics doivent garantir une concurrence loyale et la maîtrise des fonds publics, tout en intégrant les objectifs de développement durable définis par la transition écologique européenne et française.
La réglementation fait une place importante à la prise en compte des objectifs sociaux et environnementaux. Les directives européennes, traduites dans le droit interne, introduisent la possibilité d’appliquer des critères de sélection liés à l’impact écologique et social des offres.
Intégration du développement durable dans la commande publique
Les considérations de développement durable doivent être intégrées dès la définition des besoins, notamment dans la rédaction du marché et des cahiers des charges.
Les acheteurs publics exigent généralement la prise en compte de la gestion des ressources, de la réduction des émissions, du respect de la biodiversité et de l’impact sur les populations locales. Ces critères s’inscrivent dans la transition écologique et répondent à des attentes fortes de responsabilité.
Pour préciser ces attentes, les documents tels que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) détaillent les performances sociales et environnementales requises. Les fournisseurs doivent ainsi démontrer leur capacité à répondre à ces exigences via des preuves concrètes, comme des certifications ou des rapports de performance.
Exigences des acheteurs publics en matière de durabilité
Les critères de sélection des acheteurs publics couvrent plusieurs dimensions, souvent regroupées ainsi :
| Capacité | Exemples d’exigences liées à la durabilité |
|---|---|
| Économique et financière | Stabilité pour investir dans des processus durables ; gestion du risque environnemental. |
| Technique et professionnelle | Compétence en éco-conception ; expérience dans des projets durables ; certifications ISO 14001 ou équivalent. |
| Responsabilité sociale et environnementale | Démarche RSE, politique d’achats responsables, gestion durable de l’énergie et des déchets. |
Les offres sont évaluées sur la base de ces critères, souvent pondérés pour favoriser les engagements concrets en faveur du développement durable et de la transition écologique. Les réponses doivent non seulement respecter les exigences minimales, mais aussi présenter des actions mesurables et adaptées spécifiquement au secteur du tourisme durable.
Construire une offre compétitive pour les marchés publics de tourisme durable

Remporter un marché public de tourisme durable repose sur une préparation précise, la valorisation de pratiques responsables et la capacité à anticiper les exigences spécifiques des acheteurs publics. La compétitivité d’une offre dépend à la fois de sa structure, de la pertinence de ses arguments et de l’adaptation constante aux évolutions du secteur.
Structuration de la réponse à l’appel d’offres
Une offre compétitive exige une organisation claire et respectueuse des attentes formalisées dans le dossier de consultation. Il est essentiel de suivre le plan imposé, de hiérarchiser les informations et de joindre tous les documents requis.
Les contenus doivent être précis : méthodologie de gestion, calendrier opérationnel, profils de l’équipe dédiée, références similaires et moyens techniques. Inclure un tableau synthétique des engagements pour chaque critère (prix, délais, impact environnemental) permet aux acheteurs publics de comparer facilement la proposition.
Le respect des critères de sélection (exigences techniques, performance environnementale, prix) doit être démontré de façon transparente. Une bonne anticipation des questions possibles renforce la crédibilité de la réponse.
Argumenter sur la valeur ajoutée durable
Pour convaincre, il faut démontrer en quoi l’offre contribue aux objectifs de développement durable des acheteurs publics. La présentation des actions environnementales concrètes (mobilités douces, gestion des déchets, économies d’énergie) est indispensable.
Mettre en avant la réduction de l’empreinte carbone ou l’intégration de fournisseurs locaux donne du poids à la candidature. Il est pertinent d’expliciter les indicateurs de suivi et d’évaluation environnementale utilisés.
Un tableau ou une liste claire peut résumer les bénéfices durables pour les parties prenantes :
- Mobilité verte des visiteurs
- Sensibilisation des usagers
- Partenariats responsables
Des exemples concrets démontrant l’impact positif sur le territoire valorisent la démarche.
Veille et anticipation des attentes des acheteurs
La compréhension précise des profils et attentes des acheteurs publics est un atout déterminant. Un suivi régulier de la publication des avis d’appel d’offres et une analyse des politiques locales de développement durable sont nécessaires.
L’offre doit anticiper non seulement les critères techniques et financiers, mais aussi les priorités émergentes : inclusion, accessibilité, innovation sociale, circularité. Une matrice de veille peut structurer l’identification des tendances et besoins identifiés dans les cahiers des charges récents.
Dialoguer en amont avec les acteurs du secteur et assister à des réunions d’information aide à ajuster en continu la pertinence des propositions et à répondre précisément aux attentes.
Intégrer la RSE dans sa proposition

La prise en compte de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un critère de plus en plus décisif dans l’attribution des marchés publics de tourisme durable. Il s’agit d’articuler engagements, actions concrètes et mesures de suivi pour répondre parfaitement aux attentes des acheteurs publics.
Valorisation des engagements RSE
Pour convaincre lors d’un appel d’offres, il est essentiel de présenter clairement les engagements RSE déjà intégrés à la politique de l’entreprise. Cela passe par une explication précise des valeurs portées, des chartes signées, ou des labels obtenus comme ISO 14001 ou la certification AFNOR RSE.
Les entreprises peuvent lister leurs engagements à l’aide d’un tableau synthétique. Par exemple :
| Engagement | Description | Référentiel |
|---|---|---|
| Réduction CO₂ | Bilan carbone et plan d’action | ISO 14064 |
| Inclusion sociale | Embauche locale, parité | Charte diversité |
Il est également pertinent de rappeler l’alignement avec les ODD des Nations Unies ou la stratégie climat nationale, pour montrer que la démarche ne se limite pas à une conformité de surface.
Mise en avant des actions concrètes en développement durable
Les actes concrets pèsent plus que les intentions. Il est recommandé de décrire brièvement mais précisément les actions mises en œuvre, par exemple : optimisation des déplacements professionnels pour limiter l’empreinte carbone, utilisation de fournisseurs locaux, gestion responsable des ressources comme l’eau et l’énergie.
Il peut être utile d’illustrer ces initiatives avec des données factuelles, des retours d’expérience chiffrés ou des résultats tangibles obtenus sur des projets antérieurs. Mentionner les renouvellements d’équipements avec des produits éco-labellisés ou la formation régulière des équipes au développement durable renforce la crédibilité du dossier.
Les entreprises peuvent aussi recourir à une liste à puces pour structurer les principales actions menées, ce qui facilite la lecture du mémoire technique.
Évaluation et suivi de la performance RSE
L’évaluation des actions RSE repose sur des indicateurs fiables et suivis dans le temps. Il est conseillé de présenter des KPIs spécifiques (par exemple : pourcentage d’émissions de CO₂ réduites par an, part des achats responsables, taux de sensibilisation des salariés).
La mise en place de tableaux de bord permet de prouver l’évolution continue des démarches engagées. L’audit externe ou interne des pratiques, voire la publication de rapports RSE, renforce la transparence et la confiance des acheteurs.
Présenter un plan d’amélioration continue et la fréquence des suivis réalisés permet de montrer que l’engagement en matière de développement durable s’inscrit dans la durée et n’est pas ponctuel.
Stratégies pour maximiser ses chances de succès

Pour remporter un marché public de tourisme durable, il faut allier une compréhension fine des critères de sélection à une valorisation mesurable des bénéfices environnementaux et sociaux proposés. La réussite passe aussi par l’ancrage territorial et des collaborations stratégiques.
Analyse des besoins et attentes spécifiques
Les acheteurs publics dans le secteur du tourisme durable attendent des offres parfaitement alignées avec les objectifs de transition écologique et de développement durable locaux.
Il est essentiel de commencer par une étude approfondie du cahier des charges, des politiques environnementales du donneur d’ordre et des dynamiques touristiques de la région.
Une approche efficace consiste à organiser des réunions de cadrage ou à poser des questions précises pendant la phase de consultation pour clarifier :
- Les attentes en matière d’éco-responsabilité
- Les indicateurs de suivi
- Les contraintes réglementaires et budgétaires
L’offre doit être structurée de façon claire, personnalisée et démontrer une excellente compréhension des impacts attendus. Appuyer la proposition avec des données chiffrées et la mention d’expériences similaires rassure l’acheteur public.
L’intégration des principes du développement durable doit être concrète et mesurée, pas simplement déclarative, pour se démarquer lors de la sélection.
Il est conseillé de présenter un plan détaillé d’actions environnementales, couvrant, par exemple :
- Les dispositifs visant à limiter l’empreinte carbone (mobilité douce, gestion raisonnée des ressources)
- Les actions pour protéger la biodiversité et valoriser les patrimoines naturels locaux
Côté social, l’offre doit inclure des axes d’inclusion :
- Emploi local et insertion professionnelle
- Accessibilité à tous les publics
L’utilisation de certifications (ex : ISO 14001, Ecolabels) et le calcul prévisionnel des retombées écologiques et sociales constituent des leviers de crédibilité et de différenciation.
Collaboration et partenariats locaux
L’ancrage territorial favorise la réussite des projets de tourisme durable et rassure sur leur viabilité à long terme.
Nouer des partenariats avec des entreprises locales, des associations environnementales ou des acteurs institutionnels permet :
- D’intégrer des savoir-faire du territoire
- De maximiser la création de valeur ajoutée locale
Ce réseau démontre la capacité du candidat à fédérer autour de solutions adaptées au contexte. Présenter un schéma partenarial clair, ainsi qu’une lettre de soutien ou un accord de partenariat, renforce la solidité du dossier. La collaboration locale est également un atout souvent valorisé dans la grille de sélection des acheteurs publics.
Transition écologique et innovation dans le tourisme durable

Les acteurs du tourisme doivent s’adapter aux évolutions environnementales, intégrer l’innovation et respecter les normes en matière de développement durable. Ces changements transforment l’approche des marchés publics et favorisent l’émergence de nouvelles pratiques responsables.
Adoption de solutions innovantes pour le développement durable
L’adoption de solutions innovantes permet aux entreprises de tourisme de réduire leur impact environnemental tout en restant compétitives. L’intégration d’outils de mesure de l’empreinte carbone, la gestion intelligente des ressources (énergie, eau, déchets) ou l’utilisation d’énergies renouvelables deviennent des axes majeurs.
Parmi les initiatives efficaces, on retrouve l’application de labels reconnus comme la « Clef Verte » ou « Écotable », qui renforcent la crédibilité des structures lors des appels d’offres. L’innovation intègre aussi la digitalisation, avec des plateformes de réservation écoresponsables et des outils d’auto-diagnostic environnemental soutenus par des organismes publics.
D’autres éléments clés incluent la sensibilisation des visiteurs, le développement d’expériences immersives valorisant la biodiversité, et la collaboration entre acteurs locaux. L’innovation structurelle va au-delà de la simple conformité et crée un avantage dans la réponse aux attentes des marchés publics exigeants.
Réponses aux nouvelles exigences réglementaires
La transition écologique dans le secteur du tourisme implique l’anticipation et la compréhension des dernières réglementations, souvent renforcées par la commande publique. Les marchés publics de tourisme exigent aujourd’hui la prise en compte claire de critères de développement durable, traduits par des clauses environnementales précises.
Les entreprises doivent systématiquement intégrer des indicateurs de performance environnementale dans leurs propositions, en s’appuyant sur les outils mis à disposition par des institutions telles que l’ADEME. Par exemple, l’utilisation du référentiel « Label Bas Carbone » ou des solutions d’auto-diagnostic environnemental facilite la démonstration de conformité auprès des acheteurs publics.
Le respect des normes éco-responsables (gestion des déchets, suivi des consommations, actions sur la biodiversité) devient un élément différenciant et souvent obligatoire pour remporter un marché. Il est donc essentiel d’adapter ses pratiques pour répondre à ces nouvelles attentes réglementaires.
Exemples de bonnes pratiques et retours d’expérience
Des territoires et entreprises ont mis en place des pratiques concrètes pour accélérer la transition écologique dans le secteur. À Marseille, des restaurateurs ont suivi un accompagnement pour obtenir le label « Écotable », améliorant leur performance environnementale et leur positionnement lors des consultations publiques.
Des outils comme l’autodiagnostic environnemental, développés par le Commissariat général au développement durable, aident les sociétés à évaluer leurs impacts et à structurer des plans d’action efficaces.\
En région PACA, un guide de bonnes pratiques aide les entreprises à formaliser leur stratégie durable tout en valorisant leurs efforts dans une logique de transparence.
Voici quelques exemples synthétiques :
| Pratique mise en œuvre | Bénéfices pour le marché public |
|---|---|
| Labellisation environnementale (« Clef Verte ») | Renforce l’attractivité du dossier |
| Formation du personnel aux éco-gestes | Optimise la gestion des ressources |
| Réduction des déchets et suivi des consommations | Répond aux critères environnementaux |
L’analyse et la valorisation de ces retours d’expérience sont essentielles pour adapter sa stratégie et proposer des offres plus compétitives et responsables.
Questions fréquentes

Les marchés publics dans le secteur du tourisme durable exigent une préparation précise, la mise en avant de critères responsables, et la capacité à démontrer des engagements concrets. Il devient essentiel de maîtriser les référentiels, anticiper les attentes en matière d’écotourisme et présenter des preuves fiables d’actions durables.
Quelles sont les stratégies clés pour élaborer une offre gagnante pour un marché public dédié au tourisme durable ?
L’analyse attentive du cahier des charges permet d’identifier les priorités de l’acheteur public. Il est recommandé de valoriser l’innovation et de proposer des solutions mesurables pour la réduction des impacts environnementaux.
La présentation claire des références antérieures dans des projets de tourisme durable aide à renforcer la crédibilité de l’offre.
Comment peut-on démontrer l’engagement en faveur du développement durable dans une proposition de marché public ?
Inclure des plans d’action détaillés sur la gestion des ressources naturelles, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’implication des parties prenantes locales montre un engagement solide. Joindre des bilans environnementaux et des rapports de suivi renforce la transparence.
Utiliser des indicateurs précis, tels que la part des achats responsables ou la politique de gestion des déchets, apporte des preuves concrètes.
Quels sont les critères communs d’évaluation des appels d’offres en matière de tourisme durable ?
Les critères incluent souvent la performance environnementale, la qualité technique de la prestation, le rapport qualité-prix, et la capacité à impliquer les acteurs locaux. La méthodologie proposée pour limiter l’empreinte écologique du projet est régulièrement évaluée.
Certains appels d’offres imposent des seuils minimaux de respect des normes environnementales ou attendent des solutions de mobilité douce.
De quelle manière les certifications environnementales influencent-elles l’attribution des marchés publics dans le secteur du tourisme ?
La possession de certifications reconnues (par exemple, Écolabel européen, Green Key, ISO 14001) bonifie le dossier du candidat. Les acheteurs publics se fient à ces labels pour évaluer le sérieux des engagements environnementaux affichés dans l’offre.
Ils facilitent la comparaison entre les candidats et permettent aux pouvoirs adjudicateurs de limiter les risques liés à la conformité réglementaire.
Quels sont les pièges à éviter lors de la soumission à un appel d’offres pour un marché public de tourisme durable ?
Une lecture superficielle des exigences techniques ou l’absence de preuves vérifiables d’actions durables sont des erreurs fréquentes. Il est risqué de surestimer ses capacités ou d’ignorer les attentes sociales liées à l’impact du projet.
L’oubli de formaliser ses engagements ou de répondre à toutes les questions du dossier peut entraîner un rejet automatique de la candidature.
Comment intégrer des pratiques d’écotourisme dans une proposition pour remporter un marché public lié au tourisme durable ?
Il est recommandé de décrire précisément les pratiques : utilisation d’énergies renouvelables, limitation des plastiques à usage unique, développement d’activités à faible impact écologique, ou partenariats locaux pour la valorisation du patrimoine.
Valoriser l’éducation des visiteurs à l’environnement et l’inclusion des populations locales ajoute une plus-value déterminante pour les décideurs.
Conclusion

Répondre efficacement à un marché public de tourisme durable requiert une compréhension fine des enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux. Il ne s’agit plus seulement de proposer une prestation touristique, mais de démontrer comment celle-ci contribue concrètement à la transition écologique et au développement local.
La réussite repose sur une offre claire, structurée et personnalisée. Chaque réponse doit s’appuyer sur des preuves concrètes d’engagement : actions menées, certifications obtenues, indicateurs de performance suivis. La capacité à anticiper les attentes de l’acheteur public, à dialoguer avec les acteurs du territoire et à démontrer un impact positif mesurable est déterminante.
L’intégration de la RSE, la valorisation des partenariats locaux, et la mise en avant de solutions innovantes renforcent la compétitivité de l’offre. Un dossier bien construit, combinant maîtrise technique, cohérence budgétaire et pertinence écologique, positionne favorablement l’entreprise face aux critères de sélection exigeants.
Enfin, le suivi de l’exécution du marché, l’évaluation continue de la performance durable, et l’adaptation aux nouvelles attentes réglementaires garantissent la pérennité des partenariats publics. Le tourisme durable ne se limite pas à un objectif contractuel : c’est un engagement stratégique qui s’inscrit dans le temps.
Je veux remporter des appels d’offres ! 🏆
À propos de l’auteur (Philippe COURTOIS)

Après une première partie de carrière dédiée au commerce et à la vente (Banque LCL, Unilever, groupe Seloger.com) je me suis spécialisé dès 2010 dans la réponse aux appels d’offres, d’abord au sein de grands groupes (Essity, Bureau Veritas, groupe Sonepar) puis en tant que Consultant Marchés Publics dans un cabinet de conseil, avant de participer enfin au lancement des marchés publics pour la Société du Grand Paris dans le cadre du plus grand projet d’infrastructure d’Europe (Grand Paris Express).
C’est fort de cette expertise concrète et issue du terrain que j’ai décidé en 2022 de lancer mon activité et d’accompagner les entreprises souhaitant augmenter leur part de marché sur le secteur public.
À propos d’AO Conquête
AO Conquête accompagne les PME souhaitant se positionner efficacement sur les marchés publics afin de gagner en croissance.
Détection des appels d’offres, analyse du dossier de consultation, construction du dossier de réponse, rédaction ou refonte de votre mémoire technique : quel que soit votre secteur d’activité, c’est toute une gamme de solutions clé-en-main que nous proposons pour accompagner votre développement commercial.
Ne passez plus à côté des appels d’offres !

Augmentez dès maintenant votre taux de réussite sur les marchés publics en contactant un expert !

En savoir plus
AO Conquête s’engage à accompagner le développement de votre entreprise en la positionnant efficacement sur le secteur public.
Ne passez plus à côté des appels d’offres et contactez-nous dès maintenant :