Remporter des marchés publics d’adaptation au changement climatique est un enjeu majeur pour les entreprises souhaitant répondre aux nouveaux besoins des collectivités publiques en matière de résilience face aux défis environnementaux. Cela implique de comprendre les attentes des acheteurs et de développer des offres techniques et financières adaptées aux exigences de durabilité.
Définition simple : Remporter un marché public d’adaptation au changement climatique consiste à proposer une solution claire, innovante et conforme aux critères environnementaux, permettant de soutenir les collectivités dans leur effort d’adaptation aux impacts climatiques.
Quelles sont les étapes clés pour gagner un marché public d’adaptation au changement climatique ?
- S’informer sur le cadre réglementaire et les orientations stratégiques des acheteurs publics.
- Identifier les besoins spécifiques exprimés dans les dossiers de consultation.
- Construire une offre qui intègre des critères d’adaptation concrets et mesurables.
- Valoriser l’expertise et les références antérieures liées à l’adaptation climatique.
- Prendre en compte l’innovation et la performance environnementale comme leviers de différenciation.
Quels leviers utiliser pour maximiser ses chances de succès ?
- Rester actif dans la veille sur les appels d’offres en lien avec l’adaptation.
- Échanger avec les acheteurs pour mieux anticiper leurs attentes.
- Collaborer avec des partenaires spécialisés pour proposer des solutions complètes.
- Optimiser la qualité et la précision des réponses remises dans les offres.
En résumé, bien préparer son approche, anticiper les besoins du secteur public et s’appuyer sur l’innovation sont essentiels pour se positionner efficacement sur le marché en pleine évolution de l’adaptation au changement climatique.
Points clés
- Comprendre les attentes réglementaires et environnementales est fondamental.
- Adapter son offre à chaque marché d’adaptation climatique augmente les chances de succès.
- L’innovation et l’anticipation permettent de se démarquer dans un secteur concurrentiel.
Comprendre le cadre des marchés publics d’adaptation au changement climatique

L’adaptation au changement climatique s’impose aujourd’hui comme un enjeu central dans la commande publique en France. Les marchés liés à l’adaptation requièrent une compréhension précise de leur cadre juridique, de leur évolution récente, et des spécificités nationales qui orientent leur mise en œuvre.
Définition et enjeux de l’adaptation climatique
L’adaptation au changement climatique désigne l’ensemble des mesures qui visent à limiter les impacts négatifs du changement climatique et à exploiter d’éventuelles opportunités. Cela inclut l’ajustement des infrastructures, la gestion de la ressource en eau ou la protection contre les risques naturels (canicules, inondations, sécheresses).
En France, l’adaptation est un pilier des politiques publiques. Elle traduit la nécessité de préparer le territoire à des conditions climatiques extrêmes anticipées d’ici 2100, parfois +4°C, selon les scénarios officiels. Les objectifs stratégiques incluent la sauvegarde des activités économiques, la préservation de la santé publique et la continuité des services essentiels.
Liste d’enjeux spécifiques :
- Protection des écosystèmes locaux
- Sécurisation des infrastructures critiques
- Prévention des pertes économiques et humaines
Évolution de la commande publique face à l’urgence climatique
La commande publique en France a évolué pour mieux prendre en compte les impératifs climatiques. Plusieurs plans nationaux, comme le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3, lancé en 2025), ont renforcé l’exigence d’intégration de critères environnementaux dans les marchés publics.
Le cadre juridique européen, en cours de révision, tend à favoriser l’innovation et la prise en compte de l’adaptation. Les lois récentes telles que la loi Climat et Résilience imposent aux acheteurs publics d’inclure des considérations d’atténuation et d’adaptation dans la préparation, la passation et l’exécution des contrats.
Mesures clés :
- Intégration d’exigences environnementales dans les cahiers des charges
- Hiérarchisation des achats selon l’urgence climatique
- Outillage des acheteurs publics avec des guides spécialisés
Particularités des marchés publics en France
Les marchés publics français relatifs à l’adaptation climatique présentent plusieurs caractéristiques notables. Ils sont encadrés par le code de la commande publique, qui prévoit des marges de manœuvre pour intégrer des critères liés à l’environnement et à l’adaptation.
Les acheteurs publics disposent d’outils spécifiques pour valoriser les offres intégrant des solutions d’adaptation. Cela peut comprendre des critères de sélection portant sur la résilience, l’innovation ou les bénéfices environnementaux. Certains marchés requièrent le suivi d’indicateurs précis pour évaluer la performance climatique des fournisseurs tout au long du contrat.
Exemples de secteurs concernés :
- Travaux d’infrastructures résistantes aux risques climatiques
- Services de gestion des ressources naturelles
- Fourniture d’équipements résilients
Les orientations stratégiques et réglementaires en matière d’adaptation

L’adaptation au changement climatique s’appuie sur des cadres nationaux structurés et des obligations réglementaires précises. Ces piliers guident l’action des entreprises souhaitant s’engager sur les marchés publics dédiés à l’adaptation.
Le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC et PNACC 3)
Le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) détermine les axes stratégiques à l’échelle nationale pour préparer les territoires aux effets du réchauffement.
Depuis 2011, le PNACC fixe objectifs, priorités et mesures concrètes. Le PNACC 3, lancé récemment, approfondit cette démarche avec 52 mesures déclinées en plus de 200 actions ciblées selon les secteurs et les vulnérabilités des territoires.
Particularités du PNACC 3 :
- Forte articulation avec les collectivités locales
- Priorité au financement des actions
- Dispositifs de suivi-évaluation renforcés
Le respect de ces orientations stratégiques constitue un argument-clé pour accéder aux marchés publics d’adaptation.
Réglementations liées à la transition écologique et à la commande publique
Les marchés publics sont fortement impactés par la réglementation issue de la transition écologique, qui impose des niveaux d’exigence croissants.
Depuis la loi « Climat et Résilience » et par l’action du ministère de la Transition écologique, les contrats intègrent des clauses environnementales obligatoires. Les acheteurs publics doivent ainsi privilégier les offres intégrant une réelle dimension d’adaptation et des critères de performance environnementale.
Exemple de critères fréquemment retenus :
| Critère | Impact attendu |
|---|---|
| Faible empreinte carbone | Réduction GES |
| Gestion durable de l’eau | Préservation des ressources |
| Solutions fondées sur la nature | Résilience accrue |
Il est donc indispensable de documenter la conformité des offres avec les exigences réglementaires les plus récentes.
Intégration des objectifs environnementaux dans les politiques publiques
Les politiques publiques d’adaptation reposent sur l’intégration systématique des enjeux environnementaux, notamment dans l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la gestion des ressources naturelles.
De nombreux plans territoriaux (plans climat, PCAET, schémas régionaux) déclinent localement les objectifs nationaux du PNACC. L’identification des vulnérabilités, la prise en compte de la biodiversité, et la gestion raisonnée des ressources deviennent des axes transversaux pour la commande publique.
Pour les opérateurs économiques, une connaissance fine de ces priorités locales et une capacité à proposer des solutions adaptées aux contextes territoriaux constituent des avantages compétitifs majeurs lors de la réponse aux appels d’offres.
Identifier et anticiper les besoins des acheteurs publics
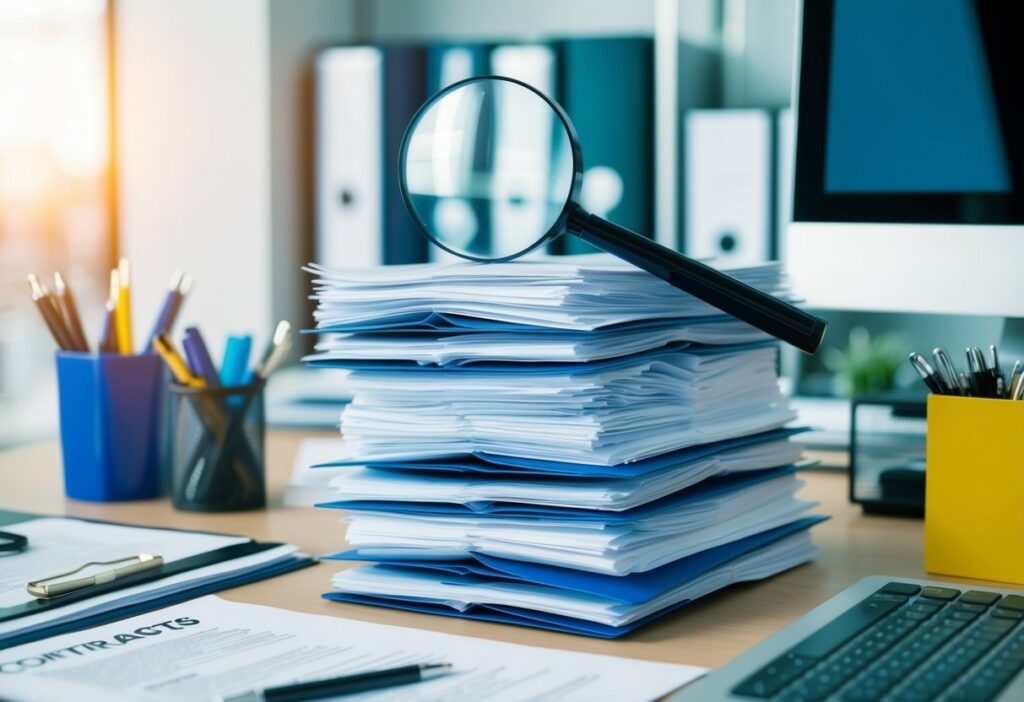
Les marchés publics liés à l’adaptation au changement climatique impliquent des exigences précises, des dynamiques sectorielles propres, et des attentes évolutives des acheteurs. Le succès dépend d’une compréhension approfondie des priorités publiques, des tendances récentes dans les appels d’offres, et de l’identification des secteurs où les investissements sont stratégiques.
Attentes spécifiques des acheteurs publics dans l’adaptation
Les acheteurs publics recherchent des solutions concrètes qui répondent aux risques liés au changement climatique. Cela inclut la gestion des inondations, l’adaptation des infrastructures face aux épisodes de chaleur ou de sécheresse, et la prise en compte de la biodiversité dans chaque projet.
L’approche attendue doit être globale. Les prestataires doivent expliciter la valeur ajoutée environnementale et proposer des méthodes innovantes de gestion des ressources, ainsi que la durabilité des matériaux utilisés.
Les cahiers des charges intègrent souvent des exigences claires relatives à la résilience, à la réduction de l’empreinte carbone et à l’intégration de critères sociaux. Il est crucial de bien analyser ces attentes lors de la préparation d’une réponse à un appel d’offres.
Analyse des tendances dans les appels d’offres
Depuis 2023, une hausse des appels d’offres spécifiquement orientés vers la transition écologique a été observée. Les collectivités territoriales et les maîtres d’ouvrage publics multiplient les projets portant sur la désimperméabilisation des sols, la rénovation énergétique des bâtiments publics ou la gestion durable de l’eau.
Des outils de veille dédiés permettent d’identifier les appels d’offres en amont, facilitant ainsi la préparation d’offres adaptées. La précision dans la définition des besoins et l’anticipation du renouvellement des marchés offrent un avantage concurrentiel significatif.
Les acheteurs publics privilégient désormais les dossiers où la compréhension fine du contexte local et les capacités démontrées à intégrer l’innovation sont mises en avant. Une analyse régulière des tendances renforce la réactivité et la pertinence des réponses.
Décryptage des secteurs prioritaires : énergie, bâtiments et infrastructures
Les principaux investissements publics en adaptation se concentrent sur trois domaines :
- Énergie : rénovation des réseaux, développement d’infrastructures renouvelables, gestion intelligente de l’énergie dans les équipements publics.
- Bâtiments : amélioration de la performance énergétique, adaptation thermique (isolation, ventilation passive), gestion des eaux pluviales.
- Infrastructures : ouvrages de protection contre les risques naturels, travaux publics pour la résilience des réseaux routiers et ferroviaires, adaptation des espaces verts urbains.
| Secteur | Actions prioritaires | Enjeux principaux |
|---|---|---|
| Énergie | Rénovation, autoconsommation, stockage | Sobriété, sécurité, coût |
| Bâtiments | Isolation, gestion de l’eau, ventilation | Confort, durabilité, coût |
| Infrastructures | Renforcement, désimperméabilisation | Résilience, sécurité |
Une veille active sur les investissements publics dans ces secteurs ainsi qu’une connaissance précise des orientations stratégiques régionales permettent de cibler les opportunités les plus pertinentes et d’y adapter une offre sur mesure.
Adapter sa stratégie pour répondre et remporter les marchés
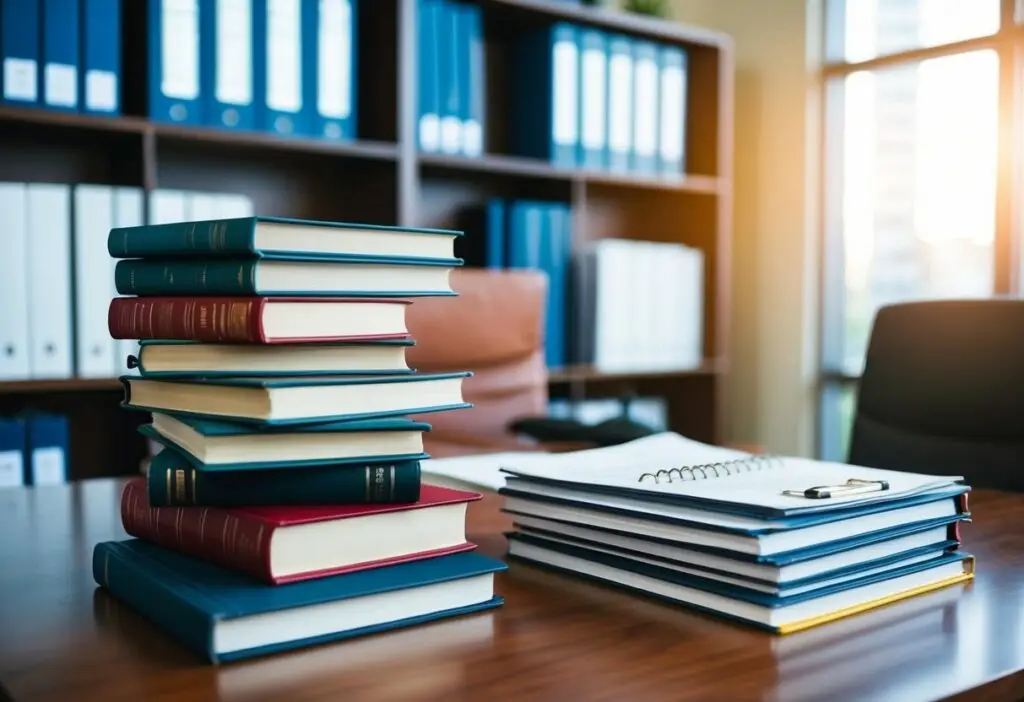
L’accès aux marchés publics d’adaptation au changement climatique nécessite une approche structurée et fondée sur des preuves. L’élaboration d’offres crédibles, la compréhension fine des critères d’évaluation et l’intégration des exigences spécifiques liées aux sécheresses, inondations et vagues de chaleur sont essentielles.
Construction d’une offre innovante et résiliente
Pour répondre efficacement, il est essentiel de concevoir une offre qui intègre des solutions techniques innovantes et testées face aux risques climatiques identifiés. Les offres doivent démontrer la capacité à anticiper et à s’adapter aux événements extrêmes, comme les sécheresses prolongées et les vagues de chaleur récurrentes.
Une attention particulière doit être portée à l’usage de matériaux durables, à la gestion optimale de l’eau, et à la flexibilité opérationnelle en cas de crise. Il est recommandé d’inclure dans le dossier :
- Une analyse de vulnérabilité du site,
- Un plan de mesures adaptatives (par exemple, dispositifs de rétention d’eau, corridors écologiques),
- Des indicateurs de suivi de la performance climatique.
La qualité du partenariat avec des acteurs spécialisés (hydrologues, urbanistes, sociologues) accroît également la robustesse de l’offre.
Critères d’attribution et différenciation concurrentielle
Les marchés publics d’adaptation s’appuient souvent sur des critères multiples : prix, valeur technique, innovation, performance environnementale et capacité à impliquer les parties prenantes. Se différencier exige de présenter des résultats mesurables et des expériences réussies sur des projets comparables liés aux sécheresses, inondations ou vagues de chaleur.
Tableau récapitulatif des critères fréquemment observés :
| Critère | Pondération typique |
|---|---|
| Valeur technique | 40–60 % |
| Prix | 30–40 % |
| Responsabilité sociale | 10–20 % |
| Performance environnementale | 20–30 % |
Mettre en avant la capacité à modéliser les risques climatiques localement et à mobiliser des technologies éprouvées renforce la crédibilité de l’offre. Ne pas négliger la clarté des méthodologies d’intervention et la qualité du dialogue avec l’acheteur public lors des phases de questions.
Exigences relatives aux solutions face aux sécheresses, inondations et vagues de chaleur
Les solutions proposées doivent répondre à des scénarios concrets et chiffrés d’aléas climatiques. Pour les sécheresses, l’installation de systèmes de récupération et de réutilisation de l’eau, ainsi que l’aménagement de végétation adaptée, est attendue. Face aux inondations, sont valorisées les infrastructures de gestion des eaux pluviales, les bassins d’orages et la perméabilisation des sols urbains.
Concernant les vagues de chaleur, il est recommandé d’intégrer :
- Des dispositifs de rafraîchissement urbain (toitures ou façades végétalisées, dispositifs d’ombrage),
- La promotion de matériaux à forte inertie thermique,
- Des plans de gestion de crise pour la population vulnérable.
La réponse doit articuler chaque solution avec des études de cas ou retours d’expérience, afin de démontrer sa pertinence et son efficacité dans différents contextes territoriaux. La transparence des indicateurs de suivi et l’engagement à adapter la solution en fonction de l’évolution des risques constituent des atouts majeurs.
Opportunités et leviers pour maximiser ses chances de réussite

Pour remporter des marchés publics dans l’adaptation au changement climatique, il est essentiel d’identifier les bons financements, de valoriser les labels spécialisés et de maîtriser les outils de veille. Ces leviers contribuent à renforcer la crédibilité des acteurs et à anticiper efficacement la compétition.
Financements et soutien aux projets d’adaptation
Les investissements publics représentent une source essentielle de financement pour les projets d’adaptation. De nombreux dispositifs européens, nationaux ou régionaux soutiennent ces initiatives, comme le Fonds Vert, Life, ou encore les aides de l’ADEME. Les collectivités intègrent souvent des critères environnementaux dans leurs appels d’offres, favorisant ainsi les projets vertueux.
Pour bénéficier de ces aides, il est crucial de structurer un dossier solide démontrant l’impact concret des solutions proposées. Les appels à projets thématiques constituent également une opportunité pour accéder à des financements spécifiques adaptés.
Quelques exemples de dispositifs utiles :
| Dispositif | Portée | Exemple d’utilisation |
|---|---|---|
| Fonds Vert | National | Adaptation des infrastructures |
| Life Programme | Européen | Projets innovants d’adaptation |
| Fonds régional Climat | Régional | Plans d’action locaux |
Rôle des certifications et labels spécialisés
Obtenir des certifications environnementales ou des labels spécialisés est un atout majeur lors de la réponse à un marché public d’adaptation. Les certifications ISO 14001, HQE ou encore le label “Adaptation au changement climatique” renforcent la crédibilité de l’organisme auprès des donneurs d’ordre publics.
Ces éléments témoignent d’un engagement structuré et mesurable en matière de durabilité et de conformité environnementale. Le tableau ci-dessous synthétise quelques labels pertinents :
| Label/Certification | Intérêt principal |
|---|---|
| ISO 14001 | Système reconnu de management environnemental |
| Label Adaptation Climat | Spécifique à l’adaptation climatique |
| HQE Infrastructures | Focus sur la haute qualité environnementale |
Un dossier incluant ces éléments se distingue lors de l’analyse des offres.
Outils et ressources pour la veille et l’anticipation des marchés
Anticiper la publication des appels d’offres et identifier rapidement les opportunités nécessite l’usage d’outils dédiés à la veille marché. Des plateformes spécialisées comme BOAMP, Marchés publics.gouv.fr, ou les outils de surveillance sectorielle, permettent de recevoir en temps réel les annonces pertinentes.
La mise en place de filtres personnalisés selon les thématiques (eau, biodiversité, énergie) aide à gagner en réactivité. Il est également recommandé d’analyser les marchés attribués antérieurement pour ajuster sa stratégie et d’intégrer les calendriers des investissements publics locaux ou nationaux à sa veille.
Enfin, des guides pratiques et webinaires sont régulièrement proposés par les chambres consulaires, clusters ou fédérations professionnelles pour mieux cibler et préparer les réponses aux marchés.
Perspectives d’évolution des marchés publics d’adaptation en France

Le marché des marchés publics dédiés à l’adaptation au changement climatique en France connaît des transformations marquées par la montée des exigences environnementales. Les orientations nationales et européennes réforment la commande publique tout en intégrant davantage d’actions contre les impacts climatiques.
Tendances à venir dans la commande publique
En 2024, la commande publique en France fait face à un contexte de ralentissement, avec une baisse observée de plus de 5% au premier semestre. Cette évolution s’explique par des contraintes budgétaires fortes et des ajustements nécessaires face à l’inflation et à la fluctuation des ressources.
Les collectivités et opérateurs publics s’orientent vers des achats plus responsables, priorisant l’intégration de critères environnementaux dans les appels d’offres. La demande se concentre de plus en plus sur des solutions innovantes permettant l’adaptation au changement climatique, comme la gestion de l’eau, la protection des sols et la réduction des gaz à effet de serre.
Un tableau synthétique des principaux domaines d’adaptation fréquemment retenus :
| Domaine d’adaptation | Exemples d’actions financées |
|---|---|
| Gestion de l’eau | Réseaux intelligents, prévention sécheresse |
| Protection contre les aléas naturels | Défenses anti-inondation, revégétalisation |
| Rénovation énergétique | Isolation bâtiments publics, énergies vertes |
Évolution des politiques nationales et européennes
La France inscrit l’adaptation au changement climatique au cœur de sa stratégie avec le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), en lien avec les directives européennes. Ce plan mobilise 52 mesures concrètes pour renforcer la résilience des territoires, encourager le « réflexe adaptation » et favoriser la commande publique durable.
Du côté européen, la révision des directives sur la passation de marchés publics impose l’intégration de la transition écologique et de critères sociaux dans les procédures d’achats. Les financeurs, tels que l’État ou l’Union européenne, orientent leurs appels à projets vers des initiatives adaptées au contexte climatique local, en métropole et outre-mer.
Les acheteurs publics français sont donc amenés à renforcer le sourcing durable et à privilégier l’innovation environnementale, en cohérence avec les stratégies nationales et communautaires.
Adaptation continue face aux nouveaux défis climatiques
Les conséquences du changement climatique – canicules, sécheresses, inondations, érosion des sols – obligent la commande publique à adapter ses cahiers des charges en permanence. Cette évolution se traduit par une demande croissante de solutions de protection, de prévention et d’anticipation des risques.
Les appels d’offres intègrent désormais des clauses relatives à la gestion de crise, à la biodiversité et à la limitation des dommages liés aux événements extrêmes. Les collectivités doivent s’appuyer sur une évaluation précise de la maturité des fournisseurs pour répondre à ces enjeux.
Il résulte de ces adaptations une offre publique de plus en plus structurée autour de l’innovation, de l’inclusivité et de l’engagement environnemental. Il en découle également une transformation des pratiques d’achat des donneurs d’ordre publics, qui s’adaptent aux évolutions climatiques et réglementaires.
Questions fréquentes

Réussir dans les marchés publics d’adaptation au changement climatique nécessite une compréhension approfondie des attentes en matière de performance environnementale et d’innovation. Les entreprises qui se distinguent sont celles capables de répondre précisément aux exigences techniques, de valoriser leurs engagements et de proposer des solutions concrètes.
Quelles sont les stratégies clés pour élaborer une proposition gagnante dans les appels d’offres sur l’adaptation au changement climatique ?
Une analyse précise du cahier des charges est essentielle pour répondre de façon ciblée aux besoins identifiés. Il est conseillé de démontrer, à travers des exemples concrets, la capacité de l’entreprise à adapter ses prestations aux enjeux climatiques et aux risques identifiés localement.
L’intégration de méthodologies et d’outils adaptés à l’évaluation d’impacts climatiques, ainsi qu’une argumentation claire sur la faisabilité financière et technique, renforcent la crédibilité de la réponse. Collaborer avec des partenaires spécialisés (bureaux d’études, experts) apporte aussi de la valeur à la candidature.
Comment peut-on se démarquer dans les marchés publics liés à l’environnement ?
Présenter des références récentes sur des projets similaires démontre une expertise reconnue. Il est utile de valoriser les résultats obtenus en matière de réduction d’empreinte environnementale ou d’augmentation de résilience face au changement climatique.
L’engagement envers l’innovation, par l’utilisation de matériaux durables ou de procédés limitant l’impact environnemental, peut aussi faire la différence. La transparence sur les moyens mis en œuvre et la communication régulière avec le pouvoir adjudicateur sont des atouts appréciés.
Quels sont les critères d’évaluation principaux pour les projets d’adaptation au changement climatique dans les marchés publics ?
Les critères d’évaluation comportent souvent la performance environnementale des solutions proposées, l’efficacité en matière de gestion des ressources (eau, énergie, biodiversité), et la compatibilité avec les objectifs européens ou nationaux d’adaptation climatique.
Les aspects financiers (coût global, maîtrise des dépenses sur la durée) ainsi que la méthodologie d’exécution du projet font l’objet d’une attention particulière. Enfin, la prise en compte de l’innovation et l’intégration d’indicateurs de suivi d’impact sont également valorisées.
Peut-on obtenir des avantages en ayant des certifications environnementales lors de la soumission à des marchés publics ?
La détention de certifications telles qu’ISO 14001 ou d’écolabels reconnus constitue un avantage concurrentiel. Elles témoignent d’une démarche structurée et d’un engagement vérifié par des tiers pour la gestion environnementale.
Les certifications peuvent être sollicitées comme justificatifs dans le cadre du dossier de candidature. Certaines procédures d’achat public attribuent des points supplémentaires ou reconnaissent formellement la valeur ajoutée de ces labels lors de l’évaluation.
Quel est le processus de qualification pour une entreprise souhaitant participer à un marché public d’adaptation au changement climatique ?
La première étape consiste à vérifier l’éligibilité administrative et la conformité du dossier de candidature. Il faut ensuite démontrer les capacités techniques, professionnelles et financières adaptées aux exigences du marché.
Des preuves d’expérience sur des projets d’adaptation ou d’innovation environnementale sont fréquemment requises. Les entreprises doivent également fournir des attestations de capacités et, parfois, des références ou certificats spécifiques à l’environnement.
Comment intégrer les innovations en matière d’écotechnologies dans les réponses aux appels d’offres publics ?
L’innovation peut être présentée à travers des fiches techniques décrivant précisément les écotechnologies utilisées, leur fonctionnement, et les bénéfices environnementaux attendus. Il est pertinent d’inclure des données probantes et des exemples d’application.
La présentation d’une stratégie de déploiement pratique, incluant la formation du personnel et la maintenance, rassure sur la viabilité de la technologie proposée. Des collaborations avec des start-ups ou des laboratoires de recherche sont également perçues positivement.
Conclusion

Face à l’intensification des aléas climatiques, les marchés publics d’adaptation représentent une opportunité stratégique pour les entreprises engagées dans la transition écologique. Répondre efficacement à ces marchés exige une connaissance fine du cadre réglementaire et des priorités des acheteurs publics, tant au niveau national que local.
L’élaboration d’une offre pertinente repose sur l’innovation, la performance environnementale et l’anticipation des risques. Les entreprises doivent valoriser leur expertise, leur capacité à co-construire des solutions durables et à intégrer des indicateurs de suivi fiables dans leurs propositions.
Les leviers comme les certifications environnementales, les partenariats techniques et l’accès aux financements publics renforcent la compétitivité. Une veille stratégique sur les appels d’offres et les tendances sectorielles est essentielle pour se positionner au bon moment avec des réponses adaptées.
Enfin, s’engager dans les marchés publics d’adaptation, c’est contribuer activement à la résilience des territoires. C’est aussi démontrer un savoir-faire responsable, capable de répondre aux défis climatiques tout en créant de la valeur environnementale, économique et sociale.
Je veux remporter des appels d’offres ! 🏆
À propos de l’auteur (Philippe COURTOIS)

Après une première partie de carrière dédiée au commerce et à la vente (Banque LCL, Unilever, groupe Seloger.com) je me suis spécialisé dès 2010 dans la réponse aux appels d’offres, d’abord au sein de grands groupes (Essity, Bureau Veritas, groupe Sonepar) puis en tant que Consultant Marchés Publics dans un cabinet de conseil, avant de participer enfin au lancement des marchés publics pour la Société du Grand Paris dans le cadre du plus grand projet d’infrastructure d’Europe (Grand Paris Express).
C’est fort de cette expertise concrète et issue du terrain que j’ai décidé en 2022 de lancer mon activité et d’accompagner les entreprises souhaitant augmenter leur part de marché sur le secteur public.
À propos d’AO Conquête
AO Conquête accompagne les PME souhaitant se positionner efficacement sur les marchés publics afin de gagner en croissance.
Détection des appels d’offres, analyse du dossier de consultation, construction du dossier de réponse, rédaction ou refonte de votre mémoire technique : quel que soit votre secteur d’activité, c’est toute une gamme de solutions clé-en-main que nous proposons pour accompagner votre développement commercial.
Ne passez plus à côté des appels d’offres !

Augmentez dès maintenant votre taux de réussite sur les marchés publics en contactant un expert !

En savoir plus
AO Conquête s’engage à accompagner le développement de votre entreprise en la positionnant efficacement sur le secteur public.
Ne passez plus à côté des appels d’offres et contactez-nous dès maintenant :











